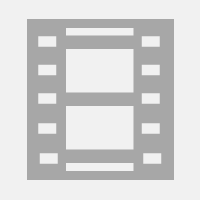De l'apprentie à l'ouvrière
Le cliché présente sur le modèle classique de la photographie de classe, sans le tablier retiré pour l'occasion, le personnel de l'atelier Sauzeau durant l'été 1942. Bien cadrée et savamment composée elle ordonne de façon hiérarchique les membres de la petite communauté ouvrière.
Au centre, légèrement en retrait, dans l'ombre mais souriante, la patronne, Camille Sauzeau ; de part et d'autre, en deux groupes de trois, les ouvrières accomplies, disposées de gauche à droite, par ordre croissant de taille plus que d'ancienneté ; au premier plan, assises à même la terre encore habillées comme des petites filles, les apprenties. Arrivées dans l'atelier vers 14-15 ans, elles restaient trois ans en apprentissage, avant d'y devenir ouvrières pour un petit nombre d'années, généralement jusqu'à leur mariage vers 20-22 ans. Selon leurs inclinaisons et talents respectifs elles se spécialisaient dans l'art délicat du flou ou moins prestigieux du tailleur et les plus compétentes prenaient en charge la formation des cadettes. Entre jeunes filles, issues de milieux comparables et d'âge rapproché, des liens de camaraderie se nouaient aisément dans l'atelier qui se prolongeait au dehors.
Une formation rigoureuse
En raison de la notoriété de l’atelier et du nombre élevé de postulantes à un apprentissage, Camille Sauzeau pouvait se permettre de sélectionner soigneusement les jeunes filles qui seraient admises à se former sous sa direction.
Elle exigeait des candidates qu’elles satisfassent à un ensemble de critères dont certains n’avaient aucun rapport avec de quelconques compétences pré-professionnelles. Il fallait que les jeunes filles « présentent bien », soient propres, polies, suffisamment instruites (elle se renseignait auprès de la directrice de l’école primaire, une amie, des résultats scolaires des candidates…) et dociles. Qu’elles possèdent au préalable quelques rudiments de couture, ce qui d’ailleurs était souvent le cas, semble lui avoir été indifférent.
Après une courte période d'essai elle leur faisait signer un contrat d'apprentissage d'une durée, inhabituelle en couture à l'époque, de trois ans. Les deux premières années, les parents des jeunes filles versaient mensuellement une petite somme pour la formation de leur progéniture auprès d'une patronne d'exception, la troisième année les apprenties percevaient la moitié du salaire d'une ouvrière.
Une employée, particulièrement douée semble-t-il et ambitieuse, Linette, put, grâce à la qualité de la formation reçue dans l’atelier, devenir par la suite « petite main » chez le grand couturier parisien Balenciaga avant d’ouvrir sa propre maison de couture dans un quartier chic de la capitale.
Camille Sauzeau était une patronne aussi intraitable sur la qualité et la quantité de travail à fournir qu’une formatrice exigeante. Elle tenait son personnel « sous clefs » et avait supprimé la pause matinale à la suite des menaces que firent courir, au début des années 30, à la réputation de l’atelier quelques ouvrières plus affranchies qui en profitaient pour aller retrouver leur flirt au café voisin.
Une ambiance conviviale
Ses qualités humaines, sa bonté unanimement soulignées par les témoins rencontrées, en faisaient l’animatrice charismatique de l’atelier pour laquelle certaines ouvrières dirent avoir éprouvé de la « vénération ». Quand elle mourut en 1977, beaucoup de ses anciennes employées douessines lui rendirent chez elle une dernière visite mortuaire avant d'assister à ses obsèques civiles. Elle aimait chanter et entraîner avec elle ses ouvrières. Les refrains à la mode, imprimés sur fascicules bon marché ou soigneusement recopiés sur des cahiers circulaient facilement dans l'atelier.
En sa présence cependant les jeunes filles ne se laissaient pas aller, censuraient leurs élans et leurs émois ; en son absence les cœurs s’épanchaient davantage, plaisanteries et farces fusaient. Il arriva que de façon volontairement transgressive, les ouvrières sortent par la fenêtre ouverte sur la rue pour aller chercher de quoi alimenter et arroser une fête improvisée, qu’elles se mettent à deux dans le manteau d’une cliente particulièrement volumineuse, valsent avec les mannequins ou hérissent d’épingles le couvre-chef de l’époux jugé antipathique d’une cliente.
Elles se retrouvaient aussi souvent hors de l’atelier pour fêter l’anniversaire, les fiançailles ou le départ de l’une d’entre d’elles. Les liens amicaux, établis sur la base d’affinités électives, se doublaient d’une sociabilité plus globale incluant les collègues de travail et les camarades d’une même classe d’âge.
Les moments forts étaient immortalisés par des photographies, volontiers échangées entre les amies et que nos témoins ont parfois conservé jusqu’à nos jours. Ainsi, la photographie mettant en scène Ginette Savarit et Albert Beunier est en possession de Marcelle Foullard, collègue et amie de Ginette depuis leurs débuts dans l’atelier.
Il ne semble pas que dans cet atelier dirigé par une libre-penseuse on ait fêté aucun des saints patrons ou saintes patronnes des couturières. Sainte-Catherine assidûment célébrée le 25 novembre dans nombre d’ateliers de couture et de magasins de mode urbains n’était l’occasion d’aucune festivité dans l’atelier Sauzeau dont par ailleurs les employées se mariaient le plus souvent bien avant le fatidique 25e anniversaire.